

Réalisé
par Minne Amélie & Yvoz Clémence.

I
Historique.
![]() Le pendule étudié par
Galilée.
Le pendule étudié par
Galilée.
![]() Du pendule à l’horloge
d’ Huygens.
Du pendule à l’horloge
d’ Huygens.
II
Principe de l’horloge à balancier.
![]() Aspect général.
Aspect général.
![]() Le fonctionnement d’une
horloge à balancier.
Le fonctionnement d’une
horloge à balancier.
![]()
 Horloge à
balancier.
Horloge à
balancier.
![]() Un pendule qui
« bat à la seconde ».
Un pendule qui
« bat à la seconde ».
![]() Le réglage des horloges.
Le réglage des horloges.
![]() L’entretient des
oscillations
L’entretient des
oscillations
![]() Le balancier.
Le balancier.

![]() Le pendule étudié par
Galilée.
Le pendule étudié par
Galilée.
Vers 1602,
Galilée découvre que les petites oscillations d’un pendule sont
périodiques : l’amplitude du mouvement diminue au cours du temps, mais la
durée d’un allé et retour de la masse reste constante.
Au XVII ème siècle, Galilée observant les oscillations
d’un lustre, a l’idée d’utiliser un pendule pour mesurer le temps :
Il explique vers 1610,
dans son ouvrage Discorsi comment
il compare des durées de descente. Un
pendule simple est constitué d’une petite boule en acier suspendue à un fil
inextensible fixé à un support.
Dans les années 1638, dans son discours concernant « Deux
sciences nouvelles » Galilée décrit une expérience de ses expériences sur
le mouvement du pendule simple, en effet il avait constaté que le mouvement
d’un pendule simple était périodique et que, pour de petites oscillations, la
période du mouvement ne dépendait que de la longueur du pendule. Cela pouvait
constituer un instrument de mesure de durée mais, les frottements amortissaient
les pendules qui finissaient par s’arrêter.
L’expérience de Galilée :
J’ai pris deux sphères égales, l’une de plomb, l’autre de liège,
celle-là bien plus de cent fois plus lourde que celle-ci, toutes deux attachées
à des fils fons et égaux, long de 4 à 5 coudées, fixés par le haut.
Puis, les ayant éloignées l’un et l’autre de verticale, je les
ai laissées aller même temps et toutes
deux descendantes le long des circonférences, des cercles décrient par les fils
le rayons égaux, dépassèrent la verticale, puis elle revient en arrière par le
même chemin et répétant bien cent fois, les même aller’ et venues elles ont
montré d’une manière évidente lourde marche tellement dans le même temps que la
légère, qu’elle ne dépasse pas ce temps ni cent oscillations, ni en mille du
plus petit intervalle, mais elle marche d’un pas tout à fait égale… Chacune des
oscillations ce fait dans des temps égaux.
En 1660, Galilée énonce les lois du pendule simple, constitué d’une
boule métallique suspendue à un fil dont l’autre extrémité est fixée à un
support:
- Première loi : période est
indépendante de la masse du pendule.
- Deuxième loi : la période
est la même pour les petites oscillations, c'est-à-dire pour une
amplitudes angulaires inférieures à 20 °
- Troisième loi : la période
des petites oscillations dépend de sa longueur : la période augmente
quand la longueur augmente.
![]() Du pendule à l’horloge
d’Huygens.
Du pendule à l’horloge
d’Huygens.
Christian Huygens (1629-1695), mathématicien, physicien et
astronome hollandais, dont le père fut un ami de Descartes, s’inspira des
découvertes de Galilée sur les propriétés des oscillations du pendule.
![Cyclophoto[1]](horlogebalancier_fichiers/image012.jpg) Vers 1650,
Huygens, crée la première horloge à pendule pesant (d’où le nom pendule) puis
la première horloge avec le balancier et ressort spiral. Les premières horloges
mécaniques à « échappement ». L’échappement est le mécanisme qui
permet de relancer légèrement le balancier à chaque oscillation qui comporte toujours un organe moteur, un
rouage, un échappement et un régulateur :
Vers 1650,
Huygens, crée la première horloge à pendule pesant (d’où le nom pendule) puis
la première horloge avec le balancier et ressort spiral. Les premières horloges
mécaniques à « échappement ». L’échappement est le mécanisme qui
permet de relancer légèrement le balancier à chaque oscillation qui comporte toujours un organe moteur, un
rouage, un échappement et un régulateur :
L’organe moteur : peut être une
masse suspendue à un câble et descendant sous l’action de son poids ou un ressort
spiral.
Le rouage : constitué de
roues dentée et de pignons, transmet le mouvement aux aiguilles et distribue
l’énergie à l’échappement.
L’échappement : fournit par
l’impulsions l’énergie au régulateur afin de compenser l’amortissement des
oscillations dû aux frottements.
Régulateur : (pendule
pesant, oscillateur à ressort spiral) assure la constante du fonctionnement.
En 1656, il eut l’idée d’introduire du balancier (ou pendule) dans le
mécanisme des horloges encore très imprécises de l’époque.
L’invention de la première horloge à pendule révolutionna
l’horlogerie !

![]() Aspect général.
Aspect général.
Dans toutes
les horloges, on trouve les mêmes éléments :
< Un oscillateur (ou régulateur), donc il s’agit du pendule,
appelé balancier. L’oscillateur impose par sa période l’étalon de la durée de
l’horloge.
< Un
dispositif d’entretien du mouvement de l’oscillateur. C’est le poids de
l’horloge que l’on doit remonter de temps en temps.
Celui-ci
accroché à un fil descend très lentement et sert à compenser l’amortissement du
mouvement du pendule.
< Un
mécanisme appelé échappement qui relie le dispositif d’entretien du mouvement
pendulaire au pendule lui-même.

![]() Le cadran et les aiguilles ont été enlevés afin de pouvoir observer
le mécanisme.
Le cadran et les aiguilles ont été enlevés afin de pouvoir observer
le mécanisme.
![]() - Engrenages
- Engrenages
![]() - Contrepoids
- Contrepoids
![]() -Balancier
-Balancier
![]() Le fonctionnement d’une
horloge à balancier (pendule)
Le fonctionnement d’une
horloge à balancier (pendule)
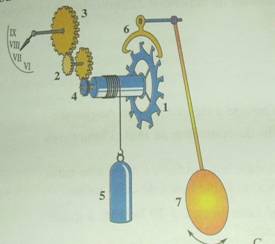
L’oscillateur est le
pendule (7)
L’organe moteur est le poids(5).Le
balancement régulier d’un pendule constitué par une masse accrochée à
l’extrémité d’une tige permet une mesure précise du temps.
Le poids(5)fait tourner la
roue d’échappement(1)et les engrenages(2),(3)et(4).L’ancre(6)reliée à la
pendule(7)rythme les rotations de la roue d’échappement(1).
![]() L’horloge à balancier.
L’horloge à balancier.
L’étalon de
temps d’une horloge est fourni par un pendule pesant. Il faut compenser
l’amortissement sans modifier la période. Ce problème a été résolu par
l’astronome et le mathématicien Christian Huygens au XVII ème siècle avec
l’invention de l’horloge à balancier.
- A chaque
battement( un demi oscillation), le balancier ibère d’un cran une roue dentée
qui est entraînée par la chute d’une « poids », le balancier a donc un
rôle de régulateur. En même temps, le balancier reçoit une impulsion par
l’intermédiaire de la fourche F : son mouvement est entretenu.
- En
remplaçant le pendule pesant par un balancier à ressort spiral, mis au point
aussi Huygens, on a pu construire des horloges ou des montres fonctionnant dans
n’importe quelle position, ce qui est indispensable, notamment, pour leur
utilisation en mer.
Celui-ci
donne alors à son tour une impulsion du balancier, ce qui entretient les
oscillations.
![]() Un pendule qui « bat »à
la seconde
Un pendule qui « bat »à
la seconde
Il faut
d’abord avoir déterminé la longueur du pendule, laquelle est facilement déduite
de la règle que les longueurs des
pendules sont entre elles comme le carré des périodes. De sorte que la longueur
du pendule qui mesure 2 secondes étant d’après notre définition de 3 pieds, sa
4èmes partie { données : 1 pied à l’époque de Huygens = 33.14 cm 1 pied
=12 pouces} c'est-à-dire que 9 pouces, conviennent au pendule qui parquera la
seconde.
Le pendule
simple est constitué d’un petit objet dense suspendu à un fil dont l’extrémité
supérieure est fixée. Ecarté d’un petit angle de sa position d’équilibre, le
pendule effectue un mouvement d’oscillation entre 2 positions extrêmes
symétriques par rapport à la verticale.
Le mouvement
du pendule simple est périodique. La période T est la durée d’une oscillation
complète du pendule ; elle s’exprime en seconde(s). La fréquence f des
oscillations est l’inverse de la période : f=1/T, elle s’exprime en Hertz.
La période
d’oscillation d’un pendule simple est indépendante de la valeur de la masse
suspendue et ne dépend que de la longueur du pendule. Le carré de la période
est proportionnel à la longueur du pendule
![]() Le réglage des horloges.
Le réglage des horloges.

Une horloge
bien réglée à un balancier qui « bat la seconde ». Lorsqu’une horloge
avance ou bien retarde, on fait coulisser le disque métallique sur la tige
verticale pour la durée des oscillations.
![]() Disque du balancier.
Disque du balancier.
Au
remonte lorsque la pendule retarde.
![]() L'entretien des
oscillations
L'entretien des
oscillations
Pour éviter
l'amortissement des oscillations dû à une dissipation d'énergie, le balancier
d'une horloge est mis en relation avec un réservoir d'énergie. Pour engendrer
un mouvement régulier, s'effectuant à vitesse constante, il faut que l'apport
d'énergie se fasse avec la même période que le pendule. La descente des « poids
» devant se faire à vitesse constante, il faut d'une manière ou d'une autre
freiner cette chute.
L'idée de l'échappement est
de brider la force motrice du « poids » (ou du ressort) pour faire tourner les rouages
à vitesse constante. Ce mouvement est obtenu par blocage et relâchement
périodique de l'axe moteur. Ce blocage résulte du mouvement oscillatoire de
l'ancre qui vient périodiquement s'opposer à l'avancement de la roue. Mais le
mécanisme à échappement doit aussi entretenir le mouvement oscillatoire qui
assure la régularité du blocage.
• Phase n°1 : La palette a
est repoussée vers le haut par la dent de la roue à échappement, pendant que la
palette b glisse vers le bas sur une autre dent. L'ancre subit une première
impulsion.
• Phase n°2 : La palette b
arrive en contact avec la dent qui suit. Celle‑ci subit une nouvelle
impulsion pendant que la palette a glisse sur la dent qui l'avait précédemment
poussée.

L'ancre subit donc deux
impulsions par période, qui sont communiquées au pendule pour entretenir son
mouvement.
![]() Le balancier.
Le balancier.
Pour faire démarrer
l'horloge, il suffit de lâcher le balancier de manière à ce que l'oscillation
initiale soit assez grande pour pouvoir laisser passer une bille. On le lâche,
et c'est tout. Cette fonction est confiée à un levier, ce qui permet un premier
balancement parfaitement dans l'axe du pendule.
Dès qu’on lâche le
balancier, celui-ci se retrouve mû par les billes des secondes. L'oscillation s'amplifie
peu à peu puis se stabilise après dix minutes. Le gain d'amplitude est
d'environ deux centimètres et ne varie plus.
La base de temps est donnée
par la longueur du balancier, elle doit être d’environ un mètre pour avoir une
bille tombante par seconde. Les tiges du balancier sont en invar, alliage qui
ne se dilate pas avec les fluctuations de la température ambiante. Le balancier
lui-même fut usiné dans un lingot d’étain de 17 kilos pour assurer assez
d’inertie. Le réglage grossier s’effectue en vissant ou dévissant la vis
supérieure, ce qui lève ou baisse l’ensemble de la masse du balancier. Le
réglage fin se fait en vissant ou dévissant la petite masselotte graduée au
fond.